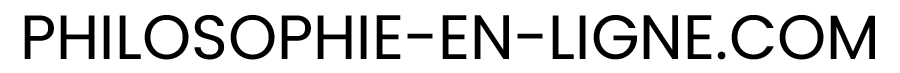Introduction à la question du mal (révisé le 7-12-23)
Conférence du 11 Octobre 2023 à l’Université Populaire de Narbonne
Texte en format PDF : cliquer ici.
Il y a des gens qui voient le mal partout ; pour eux tout n’est qu’intérêt, égoïsme et manipulation : ils ne peuvent pas croire qu’une action soit désintéressée et l’idée de générosité les fait ricaner ; ce sont de mauvaises personnes auxquels nous sommes heureux de ne pas ressembler, si c’est le cas[1]. Il y en a d’autres qui ne le voient nulle part ; ce sont des innocents qu’il faut protéger autant qu’on le peut mais dont la perte est déjà écrite[2]. Il y a aussi ceux qui le dénient et qui gardent bonne conscience jusque dans les pires exactions qu’ils commettent. Ou bien ils les imputent à leurs victimes : « Regarde ce que tu m’obliges à faire ! » crie le père à l’enfant auquel il vient d’asséner une gifle si formidable qu’elle l’a rendu momentanément sourd d’une oreille, le tympan crevé. Ou bien ils opposent à l’évidence de ce qu’ils ont fait une idée d’eux-mêmes que rien ne peut ébranler : celui qui a reconnu avoir tabassé à mort le chauffeur d’autobus qui lui demandait de respecter les consignes du transport en commun a ensuite fait cette déclaration devant la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques : « Je n’ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Je suis quelqu’un de normal, quoi. »[3]
Une typologie s’impose donc d’emblée, qui est celle de la responsabilité, nonobstant qu’elle soit assumée ou qu’elle ne le soit pas. La voici :
Le mal, c’est ce qu’on admet quand on est quelqu’un de mauvais ; c’est ce qu’on veut quand on est quelqu’un de méchant ; c’est ce qu’on empêche quand on est un héros (catégorie aussi peu nombreuse que celle des personnes vraiment méchantes), c’est enfin ce qu’on tolère quand on est quelqu’un d’ordinaire. Elle est chapeautée par l’indication de l’universel : le mal est ce qu’il est impossible à quiconque de ne pas reconnaître – ce qui s’opère toujours malgré soi et à son corps défendant puisque chacun (ou presque) souhaite plus ou moins consciemment que les choses de la vie extérieure et intérieure soient simples et belles. Ouvre-t-on en effet le journal du matin que le spectacle de l’injustice, de l’oppression, de la violence, de la haine, de l’indifférence à la souffrance animale et humaine ne manque pas de sauter aux yeux – jusqu’à celui de la cruauté où le mal se redouble en quelque sorte lui-même.
Comment ne pas être saisi d’effroi, quand on est quelqu’un comme nous autres qui ne sommes pas de mauvaises personnes puisque notre vie est plutôt faite de bonne volonté et que nous ne sommes étrangers ni à la pitié ni à la compassion ? Mais il faut bien vivre, comme on dit, alors chacun reprend ses occupations, non sans se rendre compte qu’il consent intérieurement à cette même indifférence qui l’indignait chez les autres quand elle apparaissait au grand jour.
Une notion que nous ne cessons de valider
Il est vrai qu’elle n’a pas toujours la même portée : les puissants du monde sont coupables de ne pas agir, alors que les gens ordinaires n’ont ni la possibilité d’arrêter les guerres ni celle de libérer les prisonniers politiques. Mais ce qui importe le plus, on l’a souvent noté[4], ce n’est pas tant qu’on fasse le mal puisque les personnes vraiment méchantes sont plutôt rares, c’est qu’on y consente. Non pas simplement en idée, parce qu’alors cela ne concernerait que l’idée du mal qui ne porte pas à conséquences, mais réellement.
Consentir réellement au mal, cela consiste à admettre ce qu’il est contradictoire qu’on puisse admettre, autrement dit ce qu’on ne peut admettre qu’en se contredisant. Le mal est en effet ce dont on ne peut pas se représenter qu’on puisse être sujet (« comment un être humain peut-il infliger cela à un être humain ? »), comme en témoigne qu’on se cache pour le faire, y compris à ses propres yeux en se donnant toutes sortes de « bonnes » raisons (la première, admise par tout le monde sans que sa duplicité n’échappe à personne, étant celle qu’on vient de mentionner : « il faut bien vivre »).
En ce qui nous concerne, en effet, ne manquent pas les exemples de consentements à ce à quoi il est impossible de se représenter que l’on consente. Ainsi du quasi esclavage de populations entières pour nos vêtements et nos équipements domestiques, des tueries sans nombre pour notre nourriture, du saccage de la nature, à quoi il faut ajouter notre indifférence – certes apitoyée – envers les malheureux qui dorment dans la rue devant notre maison soigneusement cadenassée.
Consentir ne peut concerner que ce qui apparaît comme un mal et par là en est déjà un ; pour cette raison un consentement n’est jamais une acceptation. Consentir à un mal identifié comme tel, et ainsi consentir au mal absolument parlant, ce n’est pas du tout l’accepter mais c’est l’admettre comme mal et cesser de le refuser. Si telle est notre conduite, alors devient vrai, comme notre responsabilité même, que soit ce qui ne doit pas être, et que ne soit pas ce qui doit être. Et cela, c’est le mal dans l’absolu non seulement de sa notion mais de sa position.
Ainsi sommes-nous responsables non seulement du mal que nous faisons tous plus ou moins (petites entorses aux principes dont nous prétendons nous réclamer, paroles blessantes qui nous échappent, négligences auxquelles on néglige de remédier, etc.) mais du mal tout court dont il est dès lors impossible de considérer la notion comme arbitraire.
L’argument est paradoxal, mais il s’impose : à cause de nous qui consentons réellement à des réalités dont la notion en est celle de l’impossibilité qu’on y consente, il est impossible que la reconnaissance du mal soit quelque chose d’arbitraire.
A quoi consentons-nous, s’il n’y a rien ?
A le reconnaître, on reste confronté à une responsabilité, la nôtre, qu’on n’arrive pas à se représenter pour la raison simple qu’on ne voit pas de quoi elle est la responsabilité. Du mal, d’accord, mais est-ce que c’est quelque chose, le mal ?
La première réaction de quiconque réfléchit est d’en pointer le caractère purement imaginaire. En effet c’est seulement de notre point de vue, selon nos besoins, nos désirs, nos habitudes ou nos idéaux, qu’on peut parler d’un mal par défaut ou au contraire par excès. Ces idées n’ont aucun sens en soi. Ainsi pour le sage, qui s’en tient à ce qui est et qui a compris que les choses et les êtres ne sont jamais que ce qu’il était impossible qu’ils ne soient pas, la notion du mal n’a d’autre sens que d’être illusoire, pour la très bonne raison qu’elle ne correspond à rien. Tous les exemples qu’on met en avant pour établir la réalité du mal démontrent au contraire l’inanité de sa notion : un scorpion ne piquerait-il pas que ce ne serait pas un scorpion, et l’effet de sa piqûre sur une grenouille ne serait-il pas la mort de celle-ci qu’il ne s’agirait pas d’une grenouille piquée par un scorpion ! Mentionner le mal, c’est parler pour ne rien dire.
Ou plutôt c’est parler pour dire, à son insu, qu’on est loin d’être sage… Le sujet de l’énoncé (le mal) se révèle n’avoir jamais été que celui de l’énonciation (le locuteur, qui ne se rend pas compte qu’il témoigne seulement du fait qu’il n’est pas sage).
A moins que la question ne soit pas celle qu’on imaginait. Car si d’un côté le sage nous dit que la notion du mal ne correspond à rien (en elle, il ne s’agit que de notre manque de sagesse en tant qu’on le méconnaît), de l’autre ceux qui ne peuvent pas ne pas la maintenir, à cause de ce qu’ils ont vu, de ce qu’ils ont subi et parfois de ce qu’ils ont fait, nous disent que la question du mal n’est pas celle des maux, en quoi tout le monde reconnaît la normalité du monde (il est normal par exemple qu’à un certain moment les défenses de l’organisme soient débordées par l’infection).
Ils justifient leur affirmation en faisant remarquer qu’on peut comprendre les maux en mobilisant les savoirs correspondants (la médecine, la sociologie, etc.), et que cela consiste à les avérer 1) comme limités parce que déterminés et 2) comme relatifs à l’être particulier pour qui ce sont des maux. Or si l’intelligence des maux ne peut pas être confondue avec la pensée du mal, c’est parce que celui-ci est à la fois illimité et absolu. Le mal est illimité parce qu’il n’y jamais de raison que ça s’arrête (forcément : il n’y a jamais eu de raison que ça commence) ; le mal est absolu parce qu’il n’est pas ce qui ne devrait pas être, comme par exemple une voiture qui ne démarre pas quand c’est l’heure d’aller au travail, mais ce qui ne doit pas être – selon une affirmation aussi catégorique, c’est-à-dire inconditionnelle, que l’impératif du même nom.
Parce que sa question ne peut d’aucune manière être ramenée à celle des maux (ni donc à celle du mal particulier que constituerait l’existence du mal en général) il appartient au mal d’être incompréhensible. Car comprendre, comme le mot l’indique, c’est limiter et c’est rapporter à autre chose ; ne pas comprendre c’est laisser illimité et ne rapporter à rien. Sauf qu’ici il ne s’agirait pas de l’habituelle ouverture à l’inconnu qui motive qu’on le réduise toujours à nouveau en produisant du savoir, mais de l’inanité même de toute tentative de compréhension.
« Pas de pourquoi »
Le mal est incompréhensible, non pas parce que nous manquerions de connaissances mais parce que la question n’est pas là – pas là où il s’agit de comprendre puisqu’en effet, comprendre c’est soit normaliser en expliquant, soit rapporter au bien en justifiant. Or la question du mal n’est ni qu’on le normalise (par exemple en le réduisant à une quelconque agressivité naturelle) ni qu’on le justifie (par exemple en en faisant le moment négatif d’un avènement en fin de compte libérateur), puisque ce serait lui donner statut de relativité alors que sa notion est celle de l’absolu : il est l’irrécusable que soit commis ce qui est commis, que soit subi ce qui est subi. Le mal, dont la notion contredit à la fois celle de relever des explications et celle de relever des justifications, se reconnaît ainsi à ce que les unes et les autres choient au pied de ce qui est arrivé.
Par les causes et les motifs et vous accèderez au négatif de la réalité comme dans l’exemple du médecin qui n’a pas d’autre moyen de sauver le patient que de le vouer à une vie d’infirme. Mais le mal n’est pas le négatif de la réalité, qui relève comme tel du régime commun de la rationalité : c’en est l’excès incompréhensible. Admettre dans notre réflexion cette incommensurabilité du mal à tout ce qui pourrait en rendre compte ne revient pas à tomber dans la pensée magique et paresseuse de considérer des effets sans cause : cela revient à reconnaître que la question du mal n’est pas là où se trouve pourtant toute question, c’est-à-dire au lieu du savoir.
Or là où est le savoir, c’est partout où il y a un « pourquoi », c’est-à-dire une raison qui ait en fin de compte à être suffisante : partout, puisque le « principe de raison » est universellement constituant. Sauf au lieu du mal lui-même : « Ici, il n’y a pas de pourquoi ! » fut-il répondu à Primo Lévi qui demandait pourquoi on l’empêchait brutalement d’apaiser sa soif en suçant un glaçon[5]. Partout il y a des raisons de brutaliser quelqu’un : de justice, de correction, de vengeance, voire à la limite de satisfaction pulsionnelle. Partout sauf au Lager : dire qu’il n’y a pas de pourquoi, c’est aussi bien dire que là, il n’y a pas besoin de raison et que c’est pour cela que c’est le lieu du mal.
D’où cette évidence : ce qui relève du mal n’est pas ce dont l’explication ou la justification manque, mais c’est ce dont ni explication ni la justification ne compte.!
Considérez par exemple les clauses iniques du traité de Versailles, la crise économique des années 30, le nationalisme allemand, le traditionnel antisémitisme chrétien et encore d’autres facteurs que les historiens et les anthropologues peuvent indiquer, et vous rendrez compte du nazisme comme idéologie populaire. Mais tout ce que vous savez sera comme rien devant le fait de ce qui est arrivé. Cela ne signifiera pas que votre savoir n’en était pas un. Cela signifie que quand on a énuméré toutes les causes (en admettant que ce soit possible), autrement dit quand tout le savoir est effectif, la question n’en continue pas moins de se poser : « pourquoi ? », de se poser encore, de se poser toujours : « pourquoi ? mais pourquoi ? ».
Tout le savoir qu’on pourrait rassembler à propos de cet acte est comme rien devant le fait absolu et définitif que soit arrivé ce qui est arrivé. Autrement dit quand même tout le savoir serait disponible, la question n’en continuerait pas moins de se poser encore et encore.
Le gouffre du non-savoir
Lors d’une interview radiophonique on a demandé à l’historien Stéphane Audouin-Rouzeau, spécialiste de la première guerre mondiale et plus généralement des violences combattantes[6], pourquoi certains soldats se livrent sur les populations civiles à des exactions d’une barbarie et d’un sadisme qu’on n’arrive même pas à concevoir – et qu’on retrouve presque à chaque fois qu’une armée s’empare d’un territoire[7]. Voici sa réponse : « Parce qu’ils le peuvent. »
Ici encore on s’étonnera : la réponse n’est pas logique puisqu’à la demande de raisons qui expliquent ou qui justifient, autrement dit à la demande d’un « pourquoi », il répond juste en indiquant des conditions qui, simplement comme telles, restent vides. En effet : dans son insuffisance par rapport à la question, la réponse n’est pas logique, et les conditions restent vides. Mais elle est vraie.
Eh bien le mal, c’est cela : que cette réponse soit vraie alors qu’elle n’est pas logique, que les conditions vides du mal suffisent pour qu’il y ait le mal. Il est sûr qu’on aura pensé le mal quand cette suffisance aura été élucidée…
Cependant tout le mal arrive dans le monde. Or la notion du monde est que toute condition le soit forcément d’une réalité qui permet de les identifier, et que le rassemblement des conditions ne fasse qu’un avec sa possibilité. Mais justement : le mal n’est pas quelque chose. Et ce qui en relève n’est pas possible puisqu’il est ce dont un sujet seulement considéré comme tel (et non pas comme tueur de la Mafia, par exemple) ne peut pas se représenter être sujet. Dans le domaine pratique il revient pourtant au même de mentionner une possibilité et de se représenter soi-même comme déterminé par elle. Si par exemple une promenade est possible pour moi, c’est que j’ai la possibilité de me représenter moi-même en train de me promener et non plus en train de travailler. Ce qui relève du mal est donc constitué d’impossibilité et de l’être dans le monde dont la définition est précisément d’être l’horizon de la possibilité en général. Et, dans cet a priori, de n’être rien que cette impossibilité (le mal n’est pas une chosequi serait impossible, soit à cause de l’incohérence de son concept, soit à cause de son incompatibilité avec les traits particuliers de sa situation).
Force est alors d’identifier ce qui relève du mal à des trous dans le tissu du monde et par conséquent de nos vies. Certains sont tout petits, à peine des accrocs. D’autres sont grands, comme par exemple celui-ci : « Je comprends qu’ils se soient emparés de l’argent, mais pourquoi avoir tué le commerçant, qui ne les menaçait pas et n’aurait jamais pu les identifier ? » D’autres enfin sont immenses. Qui par exemple peut nier que les lieux de l’extermination soient dans notre géographie des gouffres de définitive impossibilité[8] ?
D’où cette première définition du mal, opératoire et pour l’instant encore énigmatique : le mal est le trouage du monde…
Que nous nous mettions à réfléchir à ces « impossibles » qui trouent le monde, un gouffre s’ouvre sous notre intelligence. Ou alors c’est un mur contre quoi elle se fracasse, et dont le paradoxe est qu’il ne consiste en rien. Le mal, on s’y cogne à telle enseigne qu’on ne peut pas y croire (« non, ce n’est pas vrai, je ne peux pas y croire ! »). Ou alors c’est un gouffre sans fond en quoi on est toujours sur le point de glisser à force de petits arrangements, ou d’être happé parce que l’inouï de n’avoir pas besoin de raisons vient de s’abattre sur nous.
Ni le non-sens, ni l’absurde mais l’insensé.
La suffisance des conditions, c’est l’impossibilité a priori que ce qui relève du mal puisse jamais avoir un sens. Mais il n’est pas ce qui s’oppose au sens, comme une idée s’oppose à une autre, ni ce qui lui reste extérieur comme l’existence en général qui reste indifférente aux exigences de l’humanité (Camus) : c’est ce qui le contredit. Or cela n’est pensable qu’en termes d’acte.
Dans le mal en effet ce n’est pas ce qu’on fait qui compte puisque la question n’est pas celle de la réalité mais celle de la responsabilité : c’est de le faire (ce qu’on fait compte donc en tant qu’on le fait). Ainsi un homme fait le mal quand il agit dans la société comme les prédateurs agissent dans la nature (cf. les violeurs, les tueurs en série, etc. mais aussi les « requins » de la finance et « accapareurs » de toutes les sortes). La positivité qu’on aurait imaginée être celle d’une réalité (ce qu’on dit, ce qu’on fait) est donc celle du mal, quand elle n’est celle de la réalité qu’à être celle de la responsabilité (qu’on le dise, qu’on le fasse). Car on l’a dit : ce n’est pas d’être ceci ou cela que le mal est le mal, puisque les mêmes réalités pourraient également être des malheurs : c’est de relever d’une responsabilité qui soit positivement celle de l’avérer comme irréductible au malheur qu’il constitue et qui en est toute la réalité. Le paradoxe du mal, notion par définition négative, est en effet celui d’une positivité qui ne puisse s’entendre que dans le langage des verbes et jamais dans celui des noms : le mal n’est pas une réalité qui existerait d’une manière ou d’une autre, mais c’est ce qu’on est coupable de faire.
J’ai dû forger la notion d’« insistance » pour traiter ce point essentiel. On en saisira la nécessité quand j’aurai fait remarquer que la méchanceté n’est la méchanceté qu’à insister comme méchanceté – sinon ce n’est pas la méchanceté mais juste un instant de colère ou d’exaspération. Et c’est proprement constitutif du mal lui-même. Autrement dit cela ne vaut pas moins pour le mal subi que pour le mal agi. Ainsi la douleur n’est la douleur qu’à insister comme douleur, la souffrance n’est la souffrance qu’à insister comme souffrance. Ainsi en est-il aussi de tous les défauts : c’est dans l’insistance de la paresse ou de l’hypocrisie qu’on est paresseux et hypocrite, sinon il s’agit d’un moment de lassitude ou d’une concession inévitable au paraître social (Philinte n’est pas hypocrite : c’est juste Alceste qui est fou).
L’envers de ces évidences est qu’il faut en finir avec l’idée que la question du mal serait la question du non-sens. C’est faux parce que le non-sens n’est que ce qu’il est, si l’on peut dire : il n’insiste pas. Quand il insiste, ce qui est donc le mal à proprement parler, ce n’est plus cette notion négative et abstraite qu’il faut employer mais la notion paradoxalement positive et concrète de l’insensé. La notion du non-sens s’oppose à celle du sens, mais celle de l’insensé la contredit – et c’est en l’effectivité continue de cette contradiction qu’il faut voir l’insistance du mal. La question du mal est celle de ce qui est positivement insensé, et qui ne cesse d’insister – insensé en cela précisément. Le non-sens on le constate. L’absurde, on en prend son parti. Mais l’insensé, on ne cesse pas d’en être oppressé.
Car le mal n’est pas le mal. Non : le mal, c’est l’insistance du mal par quoi il est le mal.
D’où ce paradoxe que le mal ne soit rien d’autre que sa propre insistance à être le mal… C’est cela qui va être difficile à penser : le mal est une insistance dont il revient au même de dire qu’elle n’est insistance de rien, ou de dire qu’elle est insistance du mal lui-même quant à être le mal. Voilà pourquoi la question du mal prendra finalement la forme d’une énigme dont il nous appartiendra de donner le mot, et qui est la suivante : qu’est-ce qui n’est rien, et qui ne cesse pas d’insister ?
Un réel qui force. Mais lequel ?
Le mal n’est aucunement ce qui est (tout dans l’être est « normal »), ni même ce qu’on doit reconnaître (ce qui définit le rationnel) : c’est qu’il ne soit pas possible d’admettre que soit ce qui est, ou que ne soit pas ce qui n’est pas. Par cette contradiction en nous, on peut aussi bien dire que le mal est ce qu’il n’est pas possible de ne pas reconnaître (par opposition à ce qu’il serait nécessaire de reconnaître).
La reconnaissance, rappelons-le, est une prise de responsabilité : ce qu’on reconnaît, on prend sur soi qu’il soit légitime, autrement dit on se porte garant de sa légitimité à être plutôt que n’être pas, et à être ce qu’il est plutôt qu’autre chose. La reconnaissance du mal consiste donc à prendre la responsabilité de son irréductibilité au malheur, qui est toujours une sorte d’innocence (ce n’est la faute de personne si les vivants sont fragiles, par exemple). Mais cette irréductibilité à l’innocence on ne peut pas être responsable de la reconnaître puisqu’il ne s’agit de rien : on peut seulement ne pas être assez irresponsable pour ne pas la reconnaître puisqu’il s’agit du mal !
Dès lors la question du mal est celle d’une étrange butée qui vient stopper l’universelle réduction de tout à l’innocence de ce qui est explicable ou justifiable : une butée qui ne soit pas une limite à la responsabilité mais au contraire une limite à l’irresponsabilité qui consisterait à arguer de l’impossibilité qu’il n’y ait pas de raisons (donc d’excuses) à tout pour ne pas reconnaître le mal. En termes subjectifs on peut donc formuler ainsi la question du mal : qu’est-ce qui peut faire que l’être parlant arguant de ce qu’il sait ne puisse pas, par là même, être absolument irresponsable ?
En tout cas, une chose est déjà sûre : la question de la butée qui va conférer le statut d’imposture à l’invocation du savoirrenvoie elle-même à une butée subjective impossible à éluder. D’où cette évidence : le mal n’est pas ce qui sollicite notre reconnaissance mais au contraire ce qui la force.
Le mal n’est pas ce qu’on reconnaît mais ce qu’il est impossible qu’on ne reconnaisse pas. En quoi on ne désigne rien d’autre que l’insistance, qui est que le mal soit le mal. Car le mal, qui n’est pas une réalité, ne s’entend que du forçage de notre reconnaissance. Autrement dit : le mal, on ne le heurte pas parce qu’il n’est pas quelque chose, mais on se heurte à l’impossibilité sans cesse insistante de ne pas le reconnaître – que ce soit dans une nouvelle qu’on vient d’apprendre à la radio, un comportement auquel on vient d’assister dans la rue, ou les éventualités de notre conscience. Et c’est cela, se heurter au mal (à distinguer du fait de le subir, bien sûr).
Sachant ce que nous savons de la vie des hommes à toutes les échelles (depuis l’immensité de civilisations entières jusqu’à la singularité de chaque conscience), et aussi ignorants de ce dont nous serions nous-mêmes capables dans d’autres circonstances que celles que nous connaissons (et donc aussi ignorant de qui nous sommes vraiment…)[9], il est impossible que le problème du mal n’insiste pas en nous et que le travail de sape du forçage ne soit pas constamment effectif.
Autrement dit : répondre enfin à la question du mal, cela consiste à découvrir contre quoi exactement on bute quand on se retrouve dans l’impossibilité de faire valoir le savoir qu’on a de la réalité toujours neutre (les explications), et des fins humaines toujours bonnes au moins d’un certain point de vue (les justifications). On ne cesse de buter sur ce qui fait que le savoir ne compte pas, si indéniable qu’il soit. Cela revient à dire le mal, qui n’est rien, n’en est pas moins un réel.
On peut donc formuler adéquatement, et ainsi constituer, la question philosophique du mal. Inaperçue jusqu’ici, cette question est la suivante : de quoi le mal est-il le réel ?
[1] Voir le mal partout, ne serait-ce pas la définition exacte de l’enfer ?
[2] Comme le père du chanteur Jean Ferrat, qui était juif sous l’Occupation et qui, au dire de son fils, n’aurait jamais imaginé que ses voisins puissent le dénoncer. Il n’est pas revenu de déportation. (France-Culture, Une veillée chez Jean Ferrat, 31 décembre 1997).
[3] Propos exacts rapportés par La République des Pyrénées du 15 septembre 2023.
[4] On tombe fréquemment sur une citation attribuée à Burke : « La seule chose nécessaire au triomphe du mal, c’est que les hommes bons ne fassent rien ». Elle est généralement rapportée à l’idée d’Arendt, menée en bateau par la stratégie de défense d’Eichmann (Bettina Stangneth, Eichmann avant Jérusalem, la vie tranquille d’un génocidaire, Calman-Lévy 2016), selon laquelle le mal consiste à ne pas penser. Cette idée vaut pour les exécutants mais alors c’est un truisme, ou pour les témoins mais alors c’est une platitude. Qu’on veuille en faire une pensée et son absurdité apparaît, puisque c’est forcément au nom d’une idée qu’un mal systématique peut être fait. Avant d’être une politique, le nazisme est une idée, et il y avait des intellectuels parmi les nazis (Carl Schmitt reste un théoricien très important de la politique).
[5] Primo Lévi Si c’est un homme, Presse-Pocket 1992, p. 29
[6] Stéphane Audouin-Rouzeau, Une initiation (Rwanda 1994-2016), Seuil, 2017
[7] Dans le Midi-Libre du 2 Octobre 2023 on lit le rapport d’atrocités commises sur des populations arméniennes par des soldats de l’Azerbaïdjan : décapitations et dépeçage d’un maires, viols publics d’enfants…. Il y a quelques mois c’étaient des soldats russes sur des populations ukrainiennes. Le comble du comble dans la barbarie et l’atrocité a été atteint par le gigantesque pogrom du 7 novembre 2023, présenté par ses auteurs comme une opération « militaire » de « résistance ».
[8] A Nancy ma ville d’origine (exactement à l’angle du boulevard Albert 1er et de la rue de Boudonville pour les lecteurs qui connaissent), il y a un très bel immeuble bourgeois dont la Gestapo avait transformé les caves en salles de torture. Aujourd’hui encore on peut lire une plaque apposée à la Libération : « Ici d’innombrables patriotes ont mieux aimé souffrir que trahir, et leurs forces morales unies ont vaincu la violence de la Gestapo ». Pour me rendre à la bibliothèque et en revenir, je passais matin et soir devant cet immeuble et je ne me souviens pas d’avoir pu une seule fois éviter le mélange d’angoisse, de pitié, d’horreur et d’admiration que cela suscitait – et suscite toujours – en moi.
[9] Il est absurde de faire un absolu de cette remarque, comme on le voit parfois : il est vrai qu’on ne sait pas ce qu’on ferait ou ce qu’on laisserait faire dans des circonstances dont nous n’avons pas idée, mais il est faux que cette ignorance soit totale. Qu’elle ne soit pas faite de certitudes ne signifie pas qu’elle n’est pas faite de probabilités positives et négatives, certaines très grandes et d’autres très petites. (Cf. Pierre Bayard Aurais-je été résistant ou bourreau ? Éditions de Minuit, 2022)